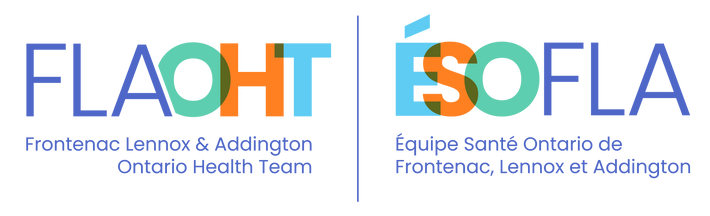Pleins feux sur le Conseil communautaire : Lynn Brant
15 octobre 2025.
Santé spirituelle, guérison traditionnelle et construction d’un avenir porteur d’espoir
Originaire du territoire mohawk de Tyendinaga, Lynn Brant est une femme mohawk fière de ses origines. Défenseure passionnée des pratiques de guérison autochtone, elle consacre une grande part de sa vie personnelle et professionnelle à élargir l’accès à la guérison traditionnelle et à faire comprendre à quel point celle-ci est indissociable de la santé et du mieux-être global.
Pionnière dans son domaine, Lynn a été la première infirmière praticienne autochtone au Centre de santé communautaire de Napanee (CSCN), avant d’exercer comme accompagnatrice en santé autochtone au Centre des sciences de la santé de Kingston. Elle est membre fondatrice du Conseil de santé des Autochtones (aujourd’hui, Conseil de la santé et du mieux-être des Autochtones ou CSMA), qu’elle copréside aujourd’hui aux côtés de Mireille LaPointe, de la Première Nation algonquine d’Ardoch. Par ailleurs, elle siège au Conseil de direction transitoire, groupe responsable de la gouvernance de l’Équipe Santé Ontario de Frontenac, Lennox et Addington (ÉSO FLA), et s’investit activement au sein du Conseil communautaire ainsi que dans une équipe qui se consacre aux stratégies de soins palliatifs autochtones. Nous avons eu le privilège de rencontrer Lynn lors d’une réunion du Conseil de la santé et du mieux-être des Autochtones pour discuter de son engagement en tant qu’actrice locale, de l’évolution du Conseil, de sa vision de la santé et du mieux-être autochtones, ainsi que de l’importance des partenariats porteurs de sens.
L’évolution du Conseil de la santé et du mieux-être des Autochtones
Le Conseil de la santé et du mieux-être des Autochtones est né d’une nécessité concrète. Fondé par Maureen Buchanan – infirmière praticienne autochtone ayant succédé à Lynn au CSCN –, il avait pour mission initiale de soutenir ce rôle et d’orienter les programmes destinés aux Autochtones. Au fil des années, le Conseil a élargi son champ d’action et accru son nombre de membres, s’adaptant constamment pour mieux répondre aux besoins et aux priorités des communautés autochtones locales. « Je suis ravie de voir comment le CSMA a évolué ces deux dernières années, souligne Lynn. De plus en plus de personnes, autochtones et non autochtones, s’impliquent désormais pour offrir des conseils et un accompagnement en matière de programmes et de soins adaptés aux réalités culturelles des Autochtones. »
Cette croissance s’est accompagnée d’une réflexion de fond. Le Conseil se penche périodiquement sur sa raison d’être et son empreinte, tout en demeurant attentif aux besoins pressants des communautés autochtones afin de maintenir son efficacité. « Nous recentrons notre action, confie Lynn. Nous rectifions le tir. À mes yeux, le Conseil doit avant tout soutenir la santé et le mieux‑être de ses membres. Nous nous posons donc la question suivante : quels sont les besoins de nos membres et quelles solutions devons‑nous mettre en place pour y répondre? » Pour Lynn, la meilleure façon de cerner ces besoins, c’est de rester à leur écouter. « Nous organisons des cercles de partage pour recueillir les témoignages des organismes membres, explique‑t‑elle. Nous leur demandons de préciser leurs priorités et d’indiquer sur quels enjeux le CSMA devrait faire porter ses efforts. C’est là l’approche autochtone : écouter les gens, puis agir en fonction de leurs attentes — c’est ainsi que nous servons au mieux la communauté autochtone. »
Qu’est-ce que la santé et le mieux-être autochtones?
Pour Lynn, la guérison traditionnelle prend racine dans la santé spirituelle et s’épanouit à travers les émotions, l’esprit et le corps. « Si nous négligeons notre esprit, nos émotions et notre être intérieur, notre corps en subit les conséquences, affirme-t-elle. Nous devons cultiver un esprit sain, ce que nous appelons en mohawk Ka’nikonhrí:io – avoir un bon esprit. »
Lors de ses études de maîtrise, Lynn a approfondi cette notion de santé spirituelle, qu’elle définit comme « un espace hors du temps, libéré de toute négativité, où l’on se sent en harmonie ». Elle compare cet état à la présence auprès d’un nouveau-né : innocence, beauté, amour et émerveillement. « La santé spirituelle, c’est s’accorder l’espace nécessaire pour être pleinement dans cet état d’esprit. »
Selon elle, il est crucial d’ancrer cette vision dans les soins quotidiens pour que la guérison autochtone gagne en reconnaissance et en légitimité. « Je suis convaincue que, si les professionnels de santé pouvaient simplement semer la graine : "Avez-vous songé à la santé de votre esprit – et à ce qu’elle représente?’", nous constaterions de meilleurs résultats physiques », souligne-t-elle. Pour y parvenir, elle insiste sur le besoin de former les professionnels, de les soutenir et de leur accorder, au sein de leurs équipes, la liberté de prodiguer des soins adaptés aux différentes réalités culturelles.
À quoi ressemble un partenariat porteur de sens?
Pour passer des principes aux actes, il faut du rythme et de la présence. L’amélioration de la santé et du mieux-être autochtones et le recours à la guérison traditionnelle exigent une conversation authentique avec les communautés autochtones. « Pour moi, il ne s’agit pas de se précipiter, explique Lynn. Si nous voulons entamer une discussion, il faut le faire de la bonne façon. » Il s’agit de ralentir, d’être pleinement présent et d’aborder le travail avec un esprit ouvert. Pour les membres de l’Équipe Santé Ontario de Frontenac, Lennox et Addington (ÉSO FLA), elle recommande comme point de départ la formation à la sécurité culturelle autochtone. « Un tel exercice profite à toutes les nations, pas seulement aux peuples autochtones. » Une prise de conscience accrue, une meilleure compréhension, la compassion et la bienveillance permettent d’aborder les soins et la vie quotidienne de la bonne façon.
Prochaines étapes
À l’avenir, Lynn souhaite voir les pratiques autochtones traditionnelles de guérison reconnues à égalité avec la médecine occidentale, et davantage de voix autochtones intégrées aux instances décisionnelles, y compris au sein des Équipes Santé Ontario (ÉSO). Son exemplarité nous invite à écouter d’abord, à faire place à l’esprit et à avancer à la cadence de la confiance. Elle encourage chaque personne à contribuer à des soins adaptés aux réalités culturelles en adoptant une approche respectueuse, en suivant des formations sur la sécurité culturelle autochtone — et en faisant l’effort conscient de mettre ces apprentissages en pratique au quotidien — et en faisant entendre les voix autochtones dans les lieux de décision.
Dans cette optique, l’ÉSO FLA co-conçoit des initiatives avec des partenaires autochtones et favorise un dialogue respectueux ainsi que l’inclusion des voix autochtones aux tables de l’ÉSO FLA. Parmi les réalisations récentes figurent l’élargissement de la formation à la sécurité culturelle autochtone, la commande d’œuvres autochtones afin de créer des cadres de soins accueillants dans les différents sites partenaires, ainsi que la collaboration avec l’Université Queen’s pour mener une recherche participative avec les communautés afin d’éclairer la gouvernance, l’engagement et les politiques de l’ÉSO FLA. L’ÉSO FLA entretient un dialogue périodique avec le CSMA, communique sur l’accès aux services et soutiens dirigés par des Autochtones, et appuie ses partenaires dans l’accès à des possibilités de formation, des ressources et des trousses d’outils. Nous continuerons de cimenter les relations et de mettre en avant les perspectives autochtones dans la planification et les soins à l’échelle régionale.
Lynn est convaincue que cet équilibre mènera à des soins de meilleure qualité et adaptés aux réalités culturelles de toutes et tous. « Je suis une femme autochtone, passionnée par la guérison traditionnelle — avec la santé spirituelle au premier plan, dit‑elle. Si je peux faire entendre cette voix, ma mission est accomplie. » Nyawen, Miigwech, merci à Lynn d’éclairer la voie.